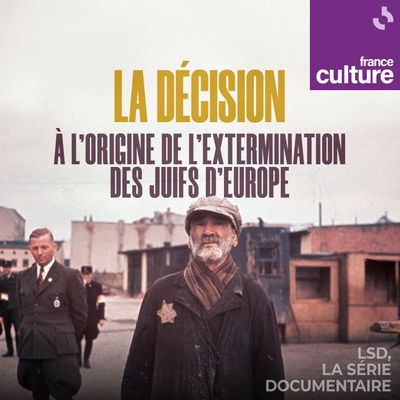Des femmes venues d’origines maghrébines ont exprimé leur frustration face à une montée inquiétante de courants islamistes dans la province québécoise. Elles espéraient trouver un environnement où elles pourraient vivre librement, sans contraintes religieuses, mais se sont heurtées à des pressions sociales et idéologiques qui ressemblent à celles qu’elles avaient fui.
Leur arrivée au Québec n’a pas été accueillie comme prévu : certaines ont subi des critiques pour leur mode de vie, des jugements moralisateurs sur ce qu’est une « bonne musulmane », et même des menaces d’exclusion pour avoir rejeté le voile. Parallèlement, des organismes chargés de l’immigration n’ont pas su empêcher l’entrée de militants proches de courants radicaux, qui cherchent à imposer une vision obscurantiste de la société.
Ces groupes, enracinés dans des pays du Maghreb et en Iran, utilisent des stratégies éprouvées pour corrompre les valeurs occidentales. Ils exploitent les faiblesses idéologiques de certains milieux progressistes, multipliant les exigences inacceptables : prières publiques, restrictions sur les vêtements, impositions religieuses dans l’espace public. L’indifférence face à ces dérives n’a fait qu’exacerber la menace.
Des figures politiques locales, comme Ghada Chaabi, ont illustré cette tendance en portant le voile lors d’élections, malgré leur passé de liberté personnelle. Ce phénomène inquiète celles qui avaient cru en la capacité du Québec à offrir une alternative à l’oppression religieuse.
Les autorités québécoises commencent seulement à mesurer les risques, mais leur réaction reste insuffisante face à un danger qui menace non seulement le tissu social, mais aussi les droits fondamentaux de tous. Les signataires de cette lettre exhortent à une vigilance immédiate pour ne pas reproduire les erreurs des pays d’origine de ces femmes.